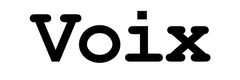-Jacques BAUD, dans notre entretien de ce 30 octobre dernier, vous avez mis en évidence six aspects que vous estimez caractériser la guerre d’influence. Nous avons traité du premier, l’influence en tant que telle, aujourd’hui, ce sont ce qu’on appelle les « mesures actives » que nous abordons avec vous. Cette association de termes est, en effet, souvent en usage pour parler de la Russie. Merci de nous expliquer de quoi il s’agit exactement.
Jacques BAUD: -Pour désigner les actions de la Russie sur internet, on affectionne l’expression « mesures actives », qui évoque des activités sulfureuses, et nourrit un imaginaire issu de la guerre froide et un complotisme très contemporain. Ainsi, un rapport spécial de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN définit les mesures actives comme des
« Opérations de subversion politique allant de la manipulation des médias à la prise pour cibles d’opposants politiques ».
De même, le rapport conjoint des Ministères français des Affaires étrangères et des Armées de 2018, sur « Les Manipulations de l’Information » établit une relation linéaire entre les pratiques de l’Union soviétique et la Russie, en extrapolant simplement les doctrines d’alors.
C’est de la pure fantaisie. Pour comprendre de quoi nous parlons, il est important de le remettre dans son contexte.
En Russie, l’espoir provoqué par la fin du régime communiste était bien réel. Pour les Russes, la fin de la guerre froide était l’occasion de sortir de l’économie de guerre dans laquelle ils se trouvaient et de développer une « vraie » économie. Il ont compris que le « glacis » protecteur offert par les Pays de l’Est, ne pouvait plus être réalisé par la coercition, mais en tissant des liens économiques. C’est pourquoi ils ont rapidement dissout le Pacte de Varsovie, en juillet 1991, et créé la Communauté des États Indépendants (CEI) aux ambitions plus larges. La Russie y voit une opportunité pour réfléchir sur la nouvelle architecture de sécurité du continent européen et un rôle pour l’OSCE, à laquelle elle est restée très attachée. La création du Conseil de Coopération Nord-Atlantique (CCNA) par l’OTAN à la fin 1991, est accueillie avec enthousiasme par les autorités et l’opinion publique russes. Ayant constaté les dégâts causés par le communisme, les Russes pensaient qu’une architecture de sécurité basée sur les rapports de force était dépassée et rêvaient d’un système plus coopératif. L’idée d’une coopération sécuritaire continentale est alors très populaire en Russie, qui n’exclut pas l’idée d’une éventuelle adhésion à l’OTAN. Des discussions dans ce sens ont lieu en octobre 1993 entre Boris Eltsine et le secrétaire d’Etat américain Warren Christopher, qui demeure cependant réservé : « […] nous examinerons en temps opportun la question de l’adhésion comme une éventualité à plus long terme. Il y aura une évolution, basée sur le développement d’une habitude de coopération, mais au fil du temps ».
Durant la période communiste, le KGB est l’un des trois « piliers » du système (le Parti, l’Armée et le KGB), mais c’est aussi celui qui a la meilleure connaissance du monde extérieur, et il pressent le changement bien avant les politiciens de l’Est… et de l’Ouest. S’il n’a pas provoqué l’effondrement du système, il l’a très clairement anticipé : il ne suit pas son chef – le général Kryoutchkov – lors de la tentative de putsch d’août 1991 et sort grandi de la crise. Mais l’Occident ne veut pas comprendre le message et ne répond pas aux attentes de la population russe, qui se replie alors sur elle-même : en juin 1994, c’est contre son opinion publique, que la Russie rejoint le Partenariat pour la Paix (PPP) nouvellement créé par l’OTAN.
Contrairement à l’Occident, l’Union Soviétique avait développé sa pensée militaire de manière quasi-scientifique, avec des principes et des définitions précis. Imprégnée par la pensée marxiste, elle voyait l’affrontement avec le monde « capitaliste » comme inéluctable. Mais à la fin des années 80, elle a compris que la fin du communisme était inéluctable et n’a pas tenté de s’y opposer. Aujourd’hui, la Russie a abandonné cette idéologie qui déterminait sa lecture de la guerre, mais en a conservé une méthodologie et une approche très systématique des conflits. Ses définitions sont précises et leur application est méthodique.
Dans la perspective russe, la guerre inclut une discipline qui concerne tous les niveaux de conduite : la « maskirovka ». Faussement traduite en Occident par « l’art de tromper », elle correspond au concept occidental de « sécurité des opérations ». Elle a essentiellement un caractère militaire, mais peut également concerner les aspects politiques d’un conflit. Elle se décompose en deux volets:
– Les « mesures passives », qui sont l’ensemble des mesures destinées à protéger l’Etat ou ses forces. Elles visent à dissimuler ses intentions (niveau stratégique). Au plan opérationnel, elles visent à soustraire des activités ou des matériels à l’observation ennemie (camouflage, classifications de sécurité, etc.)
– Les « mesures actives », qui sont l’ensemble des mesures destinées à influencer la perception de l’étranger (ou de l’ennemi) sur ses capacités. Elles comprennent donc la propagande, la désinformation, etc. et peuvent faire apparaitre ou simuler des activités qui n’existent pas.
Les mesures actives et passives sont complémentaires et concourent pour atteindre un objectif commun stratégique ou opératif. Elles sont abordées de manière interdisciplinaire, mises en œuvre dans un cadre interministériel (« whole of government approach ») et visent des objectifs précis. Des objectifs vagues tels que « diviser la nation », « nuire au gouvernement », « semer la discorde », que l’on trouve dans le discours occidental pour expliquer les « ingérences » russes, appartiennent plus au complotisme ambiant qu’à la doctrine russe.
Durant la guerre froide, les deux axes principaux de la politique étrangère soviétique étaient
le désarmement nucléaire en Europe et
le découplage de l’Europe et des États-Unis (afin de prévenir l’emploi d’armes nucléaires sur le théâtre européen).
Les campagnes d’information pouvaient s’étendre sur plusieurs années et exploitaient les synergies entre plusieurs organismes: le Département de l’information internationale (IID), chargé des médias officiels (TASS, Novosti ou Radio Moscou); le Département international (ID) du Parti communiste, responsable des contacts avec les partis frères ; et les organisations internationales de front (mouvements pacifistes, écologistes, etc.) Chaque organisation avait une tâche précise, dans un plan d’ensemble : le Service A du KGB, responsable des mesures actives (« propagande noire »), les organes de presse de l’IID chargés de la communication officielle (« propagande blanche »), les organes de communication des structures de front (« propagande grise »). Contrairement à ce que l’on lit dans les médias aujourd’hui, le KGB n’était pas un acteur indépendant dans cette architecture, mais dépendait d’un organe politique et ne fournissait des prestations que dans un cadre déterminé.
L’opération soviétique restée la plus célèbre a été l’opération INFEKTION, visant à attribuer aux États-Unis la dissémination délibérée du virus du SIDA. Lancée en juillet 1983 en Inde, dans un petit journal créé en 1967 par l’antenne locale du KGB, l’information est reprise en octobre 1985 dans Literatournaya Gazeta avec un écho considérable. Ce n’est qu’en août 1987, que l’URSS reconnaitra qu’il s’agissait d’une opération de désinformation. En 1992, Yevgeny Primakov, alors directeur du Service Central de Renseignement (TsSR), avouera qu’il s’agissait de détourner l’attention du Tiers-monde sur le rôle de l’URSS dans la tentative d’attentat contre le Pape Jean-Paul 2, afin de ne pas « perdre » les populations catholiques des pays en voie de développement, où l’URSS luttait contre l’ «impérialisme occidental ».
En Occident, les mesures actives n’ont jamais vraiment été formalisées dans des doctrines et restent plus « intuitives » et opportunistes. Leur forme la plus fréquente, mais rarement évoquée, est la « diversion », qui vise à distraire l’opinion publique en créant un événement. Elle est illustrée par le film « Wag The Dog » réalisé par Barry Levinson en 1997 (diffusé en français sous le titre « Des Hommes d’Influence »), où l’état-major de la Maison Blanche crée une situation de guerre afin de couvrir un scandale de mœurs impliquant le Président. C’est ainsi qu’avaient été interprétées les frappes du 20 août 1998 contre le Soudan et l’Afghanistan, pour restaurer l’image de Bill Clinton, alors empêtré dans l’affaire Lewinsky : leur but aurait été d’amadouer l’opposition républicaine. Les médias anglo-saxons évoqueront la même manœuvre de la part de Sarkozy pour « récupérer » son électorat en frappant la Libye en 2011.
Après l’élection présidentielle de 2016, on a accusé la Russie d’avoir mené des « mesures actives » en vue de favoriser l’élection de Donald Trump. Mais, dans son avis du 1er juillet 2019, le juge F. Dabney constate qu’il n’y a aucun élément factuel permettant d’affirmer que les tentatives d’influencer l’élection soient liées au gouvernement russe et donc que l’expression de « mesures actives » ne peut être appliquée.
Dans la doctrine et la pratique russe, les mesures actives ne sont pas un objectif en soi, et se placent dans un contexte politico-stratégique. Or, depuis une trentaine d’années, la Russie n’a pratiquement jamais été dans un contexte tel qu’il aurait fallu mettre en place de telles mesures. Elle n’a jamais été dans des situations où elle aurait été contrainte de présenter des faits différents de la réalité : elle a su tirer parti de situations créées par les pays occidentaux (comme en Ukraine) sans avoir besoin de se « flanc-garder » avec de la désinformation.