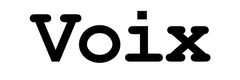Un article, paru dans le grand quotidien français autrefois dit de référence Le Monde, attire mon attention, je lis ce qu’annonce l’intitulé, « En Ukraine, rupture historique avec le peuple russe. » Dans l’espoir, oui il m’en reste, de découvrir un peu d’objectivité et de sens, je comprends que le ton est d’emblée donné.
Les Russes sont soumis à la propagande du Kremlin, même les plus proches des proches que comptent tant d’Ukrainiens car pour qui connaît un peu l’Histoire, on sait le nombre de familles qui se partagent entre Russie et Ukraine sinon encore entre d’autres anciennes républiques socialistes soviétiques.
Or tout cela a été balayé par les armes que les Occidentaux accusent la Russie d’avoir fourbi les premiers pour alimenter le conflit dont, soudain et comme lors de « La Matinale » de la RTS du 24 février, on admet qu’il dure depuis neuf ans et non un seul. Donc on revient sur cette annonce tonitruante selon laquelle l’Europe se découvrait en guerre le 24 février 2022.
Mais on revient sur cette annonce pour charger d’autant plus la Russie. Elle seule est à l’origine du désastre ukrainien. Elle seule est fautive, elle seule est cette puissance sanguinaire dont on ne cesse de dénombrer les massacres qu’elle a causés au sein d’une population qui ne demandait que la démocratie.
Que mes compatriotes soient abreuvés de propagande ne paraît pas trop les gêner, sauf celles et ceux qui conservent un sens critique. Et il en existe beaucoup. Mais dès qu’autant de ces esprits désireux d’autre chose que de partialité osent s’élever contre un discours monolithique et agressif, les voici de facto relégués aux côtés de « Poutiniens ».
De longue date, ici, j’ai alerté du gâchis annoncé et cité, à l’appui, le grand poète Alexandre Blok. Mais qui suis-je pour que ma voix ait le moindre écho sinon celui qu’on lui prête avec tant de complaisance et de malin plaisir? Depuis des années, toute personne qui refuse d’entrer dans cette sinistre mascarade occidentale est stigmatisée.
Nombre de personnalités de haut rang subissent cet ostracisme de la part de celles et ceux qui prétendent savoir. Quelle arrogance doublée, le plus souvent de mauvaise foi sinon de malveillance! Car faute d’arguments solides, on méprise, la réflexion étant inaccessible à autant de prétentieux.